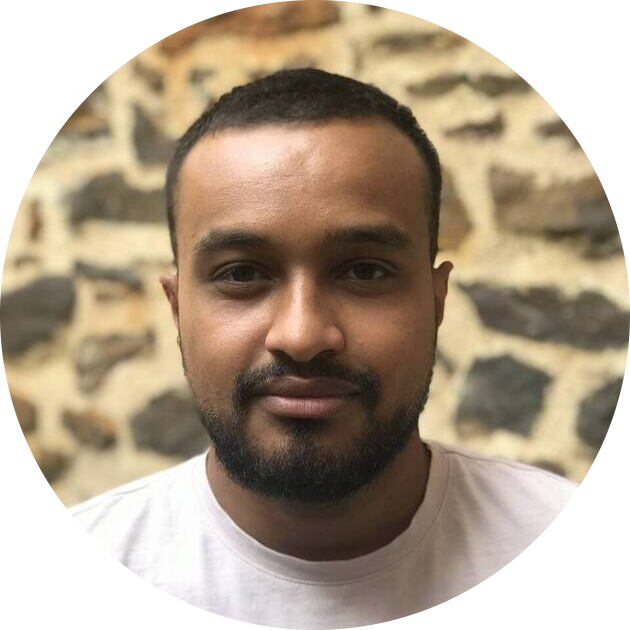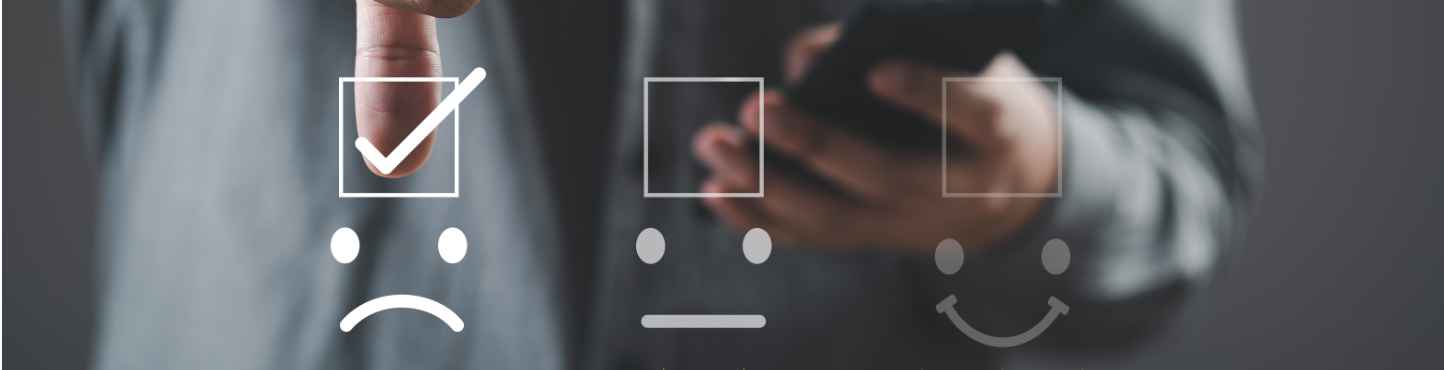Cette raréfaction de la ressource a plusieurs explications. Clément Bujisho, hydrogéologue au Syndicat du Bassin de la Sarthe, en charge de la « Gestion quantitative de la ressource en Eau » et du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau du bassin Sarthe aval, précise : la première raison est le réchauffement climatique, qui entraine une augmentation de la température de l'air à l'échelle mondiale et donc, une hausse des phénomènes évaporatoires. On passe d'une proportion d'eau liquide à laquelle on a accès, à une eau plutôt atmosphérique et à laquelle l’accès est beaucoup plus difficile. La deuxième raison, ce sont les prélèvements, donc les usages, qui sont trop importants par rapport à la ressource. Il y a une prise de conscience aujourd’hui sur le fait que trop de prélèvements ont été autorisés par rapport à ce que le milieu est capable de fournir.
Dans les faits, l’agriculture est la première activité consommatrice d’eau avec 57 % du total[1], devant l’eau potable (26 %), le refroidissement des centrales électriques (12 %) et les usages industriels (5 %). La répartition varie en fonction des bassins géographiques. Ce phénomène de raréfaction a des conséquences multiples, à commencer sur les milieux naturels. Or ceux-ci rendent aux humains, directement ou indirectement, de grands services écosystémiques. Si les sols ne sont plus capables de stocker l'eau, les ressources souterraines sont impactées, puisque leur temps de recharge est lent, explique Clément Bujisho. Cet impact est également observé sur les ressources de surface, qui nous concernent directement. Lorsque le niveau d’eau baisse trop, la qualité de l’eau est impactée, les poissons meurent, les algues se développent, les prélèvements ne sont plus possibles, les activités dépendantes de l’eau sont contraintes… Tout le système se trouve perturbé.
Autre conséquence : un impact économique qui peut être lourd pour les entreprises. Si celui-ci peut paraître évident pour l’agriculture, il l’est aussi pour l’industrie, du fait des problématiques de sécurisation de l’activité. Ainsi, faute d’accès suffisant à l’eau, certains territoires français touchés par la sécheresse ont vu des lignes de production fermées. Enfin, un autre impact loin d’être négligeable est celui sur la réglementation : qu’elle soit à l'échelle européenne, française ou territoriale, la tendance, avec l’aggravation des pénuries est vers toujours plus de contraintes, dans le but de protéger l’environnement.